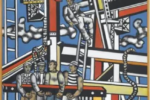Retour à froid sur le mouvement contre la réforme des retraites 2023 à Rennes Réforme libérale versus front syndical : l’épisode de lutte du printemps 2023 donne un air de déjà-vu. Il suit les autres mouvements syndicaux qui ont eu lieu en France depuis les années 70 et n’échappe pas à ce schéma classique. Les […]